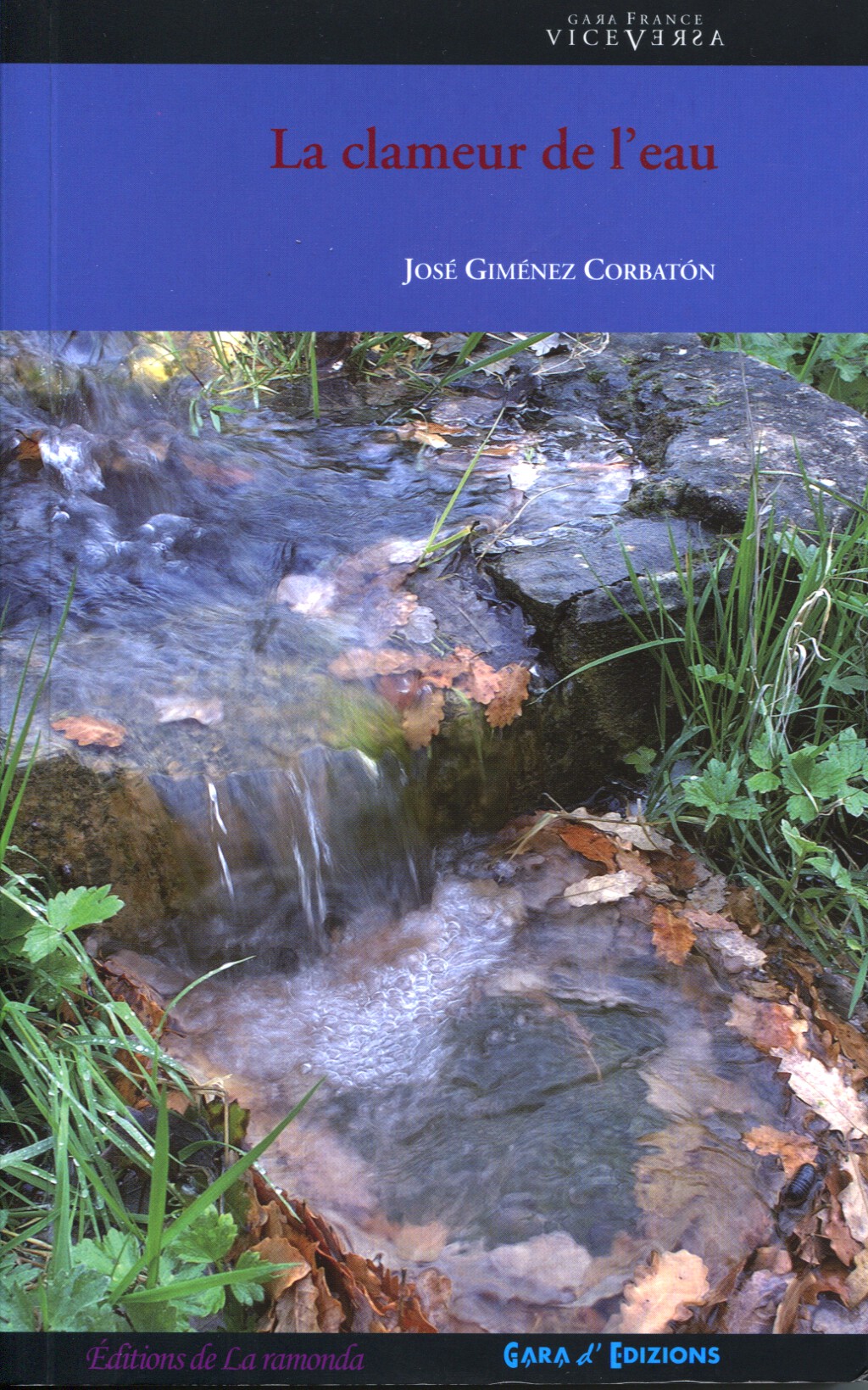Pourquoi, me suis-je demandé, des jeunes du lycée de Saint-Pierre et Miquelon, de la seconde à la terminale, auront-ils choisi pour leur prix annuel La clameur de l’eau de l’écrivain espagnol José Giménez Corbatón, en cette année 2013 ?
Pourquoi retenir un ouvrage de sept récits, le premier plongeant ex abrupto le lecteur dans une atmosphère de finitude, où la Camarde s’impose dans ses basses œuvres ? Besoin de ce témoignage de vie coûte coûte de cette vieille dame délaissée, dans sa solitude montagnarde, par son vieux mari qui vient de mourir ? Je me suis replongé à mon tour dans une Espagne de déchirures vers 1952.
Nous entrons au fil de ces pages dans les « derniers vestiges d’un monde qui s’effondrait depuis longtemps », pour en saisir les derniers soubresauts, une Espagne marquée par la guerre civile et la victoire du franquisme, les soubresauts qui perdurèrent, sans démonstrations particulières, dans les pas de personnages à l’orée de leur dernier chemin. Un choix opéré par de jeunes lecteurs. Ressenti de la fragilité quand soudain tout se désertifie ? Un potier part pour la ville, jusqu’au jour où il n’y en a plus un seul. Avons-nous ici, en écho – comme pour retenir notre souffle -, le dernier marin possible ? Beau regard, nourri d’inquiétude et de fragilité, que celui qui interroge la déperdition de bonheur et de liberté dans une société d’illusions éclatées. Qui peut s’obstiner à penser que jeunesse est forcément synonyme de frivolité ?
Récits indépendants de prime abord les uns des autres, certes, mais dans un entrelacement qui nous fait pénétrer peu à peu dans un univers de lutte pour la vie, de violence, d’amours déchirés, d’exploitation des démunis par quelques puissants, de finitude, d’espoir coûte que coûte, dans un monde rural, montagnard, où souffle une âme déchirée qui nous étreint, de par une écriture progressivement envoûtante. Le récit de Matías le Coq te laisse pantelant.
« Il faut continuer à sucer cette terre jusqu’à ce qu’il n’en reste plus rien, pas même le paysage. » p.98. L’espoir ne surgit-il pas du fait que des jeunes soient sensibles à ce terrible constat ? J’en suis au quatrième récit et tout a fait corps. Il est ici un ouvrage qui attendait d’être justement retenu. Quelle est l’importance, dans le renouvellement des générations, du fil conducteur de la mémoire ? Question obsédante, vitale, qui perle ici, comme l’eau d’une source, et qui peut émerger dans des contextes autres ; mes pensées ont soudain divagué de cette Espagne lointaine, montagnarde à mes propres interrogations chaque fois que je mets le pied sur l’Île aux marins. Mes lectures, je l’avoue, sont rarement linéaires et je retiens davantage toute création qui ouvre les chemins buissonniers de la pensée. Et c’est ainsi que j’ai réagi aux pages, dans le récit de La Roche blanche, qui évoquent tous ces objets soudain vendus dans des brocantes, dans cette symbolique terrible d’une mémoire éclatée, condamnée à l’effacement, « un monde au prétérit » (p.145). « C’était le temps des chevaux… », me suis-je mis à chanter, de Luc Romann, chanson reprise par Marc Robine. Fuite implacable du temps, avec ce qu’elle laisse d’amertume et d’inassouvi.
Ici, Crespol, pays de Teruel au nom chargé de souvenirs douloureux, un village et son environnement ; vies, souffrances, combats, divisions, affres d’une histoire tourmentée, jalousies, amours, déchirures, puis désagrégation, dispersion, exode, déperdition de mémoire, allers et retours entre passé perdu et présent lourd d’interrogations. Sur quels monceaux d’oubli portons-nous nos propres cheminements… ? Interrogations existentielles qui reviennent en boucles, semblables et renouvelées à la fois. Le récit de Diogène et les coqs s’inscrit dans cette dynamique.
À chaque étape se nourrit notre perception sphérique d’un vécu partagé par une communauté qui va en s’effilochant au fil des départs, des décès ; chaque parcours enrichit le précédent, dans la perception d’un terroir au « sol assoiffé » (p.141), assourdissant d’humanité torturée. Sans doute notre propre insularité accroît-elle la réceptivité d’une telle évocation. Est-ce là la fibre qui aura prévalu dans le choix des jeunes ? Du coup, j’ai réécouté Vivre pour des idées de Leny Escudero, puis j’ai poursuivi ma rêverie de lecteur forcément solitaire, convaincu à mon tour par la qualité de perception qui aurai ainsi prévalu. Quête perpétuelle du sens ? 176 pages nous portent dans cette direction. Ainsi se nourrit l’espérance de renaissances printanières, pour entendre – qui sait ? -, la clameur de l’essentiel…?
Henri Lafitte, Chroniques insulaires
23 mars 2013
José Giménez Corbatón, La Clameur de l’eau, Éditions de la ramonada – Gara d’Edizions – 2011 – ISBN : 978-84-8094-552-3
Disponible à la librairie Lecturama